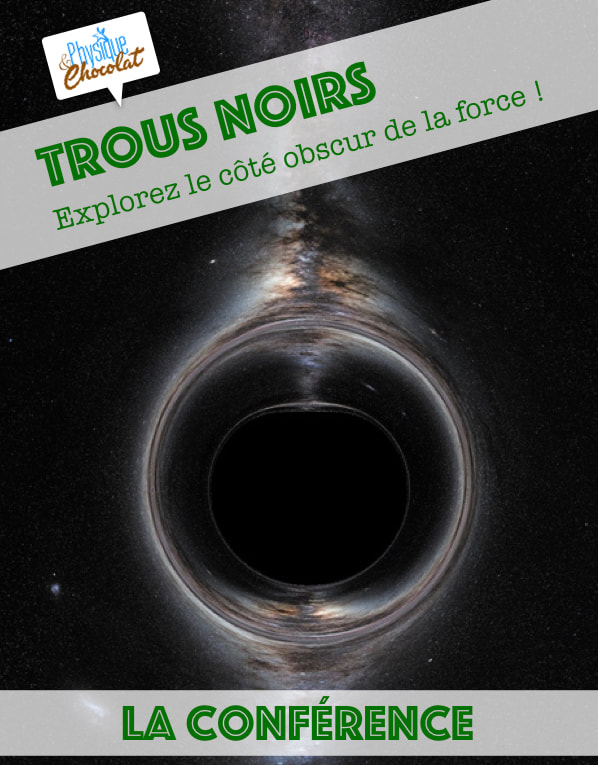Explorez le côté obscur de la force !
Les trous noirs... Prédits par Einstein il y a plus d'un siècle, ils nous fascinent toujours autant. Leur exploration débute à peine mais nous en savons déjà beaucoup sur leur compte ! L'un d'entre eux est tapi au centre de notre galaxie, dévorant la matière qui l'entoure. Je vous emmène plonger à l'intérieur de ces monstres de l'Univers, qui ne recrachent rien, même pas la lumière...
|
Les premières slides de ma conférence
Le petit film qui parle d'Interstellar et de la modélisation du trou noir et du trou de ver (en anglais) :
Une des vidéos d'Alain Riazuelo sur les trous noirs (taper "voyage trou noir" sur Youtube pour en voir d'autres)